
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 :
Cette Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) est généralement considérée comme une réussite.
Le Sommet de Rio s'est conclu par la signature de la Déclaration de Rio. Cette déclaration, qui fixe les lignes d'action visant à assurer une meilleure gestion de la planète, fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. Cependant, elle n'est pas juridiquement contraignante. Au contraire, elle reconnaît la souveraineté des États à « exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement ».

La Conférence de Berlin (COP1) en 1995 :
La première Conférence des Parties signataires de la Convention Climat (COP) se réunit à Berlin en mars 1995, et reconnaît la nécessité d'un renforcement des engagements des pays développés. Elle fixe par pays et par région d'une part des objectifs quantifiés de réduction ou de limitation des émissions, et d'autre part des politiques et mesures.

La Conférence de Genève (COP2), en 1996 :
La deuxième Conférence des Parties signataires de la Convention Climat (COP) se réunit à à Genève en Suisse en 1996. Lors de cette rencontre suivant la publication du deuxième rapport du GIEC, les pays signataires de la Convention de Rio déclarent que ''les changements climatiques représentent un danger pour l'humanité.''

La Conférence de Kyoto (COP3), en 1997 (Protocole de Kyoto) :
La Convention Climat (COP) se réunit à Kyoto au Japon en 1997. Après avoir revu les objectifs initiaux de la Convention de Rio et les avoir considérés trop faibles, les pays établissent de nouveaux objectifs. La COP3 est marquée par le renforcement de la réponse internationale à l'évolution du climat, avec l'adoption d'un Protocole fixant des objectifs chiffrés juridiquement contraignants de réduction des émissions dans les pays développés : 5,2% de réduction à atteindre en 2010 en comparaison avec les émissions de 1990, avec un objectif national précis pour chaque pays.
L'objectif de l'Union européenne est une réduction de 8 % (l'Allemagne s'engage à une réduction de 25 % et la Grande-Bretagne, de 15 %).
Il concerne les six principaux gaz à effet de serre et met l'accent sur les politiques et mesures intérieures effectivement mises en application par les états pour réduire les émissions. Il apporte une innovation : il ouvre un crédit aux parties qui réduisent les émissions de GES dans d'autres pays, par trois mécanismes de flexibilité.

La Conférence de Buenos Aires (COP4), en 1998 :
La quatrième session a lieu à Buenos Aires en 1998 et fixe un calendrier de travail pour un objectif final à atteindre en Novembre 2000 à La Haye et précise les règles de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto : système d'observance, échanges de crédits d'émission, développement propre dans le monde en développement.

La Conférence de Bonn (COP5), en 1999 :
En 1999, à Bonn puis à Lyon, de négociations sur la mise en oeuvre du plan d'action défini à Buenos Aires, notamment les mécanismes utilisés pour la réduction des emissions de gaz a effet de serre.

La Conférence de la Haye & Bonn (COP6) en novembre 2000 & juillet 2001 :
Les Parties se réunissent en sixième session à La Haye en 2000 (7000 participants de 182 pays et organisations inter- et non-gouvernementales). Les travaux sont suspendus après deux semaines de négociation sans parvenir à un accord pour rendre le protocole de Kyoto opérationnel.
Du 16 au 27 juillet 2001, l'ensemble des 180 états concernés et autres organisations intéressées (soit 4500 représentants) participent à la « COP6bis » à Bonn, pour achever le travail commencé à La Haye, la difficulté provenant cette fois du changement de politique des Etats-Unis, le Président Bush ayant décidé de ne pas ratifier le Protocole de Kyoto.
Mais ils arrivent tout de même réunion a adopté les règles pour le fonctionnement du MDP, permettant aux pays développés d'investir dans les pays en développement dans des projets en obtenant un crédit pour les émissions évitées grâce à ces projets. Les projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables (à l'exclusion du nucléaire) et de puits peuvent être pris en compte au titre de ce mécanisme, un conseil exécutif étant mis en place pour en surveiller le fonctionnement.

La Conférence de Marrakech (COP7), en novembre 2001 :
La septième conférence des parties de Marrakech de novembre permet de traduire en textes juridiques toutes les règles nécessaires à la ratification et à la mise en oeuvre effective du Protocole. De plus, la première institution du Protocole est mise en place : le conseil exécutif du MDP, mécanisme dorénavant opérationnel.
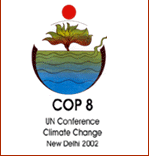
La Conférence de Delhi (COP8), en 2002 :
Cette conférence avait pour objectif principal l'achèvement de négociations techniques et l'adoption d'une déclaration.
En continuité de l'article 6 de la Convention, un programme de travail de 5 ans sur
l'éducation, la formation et la sensibilisation du public, destiné notamment à développer et à consolider la capacité d'expertise en développement a été lancé. Des compléments méthodologiques indispensables à la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto ont été adoptés : ils portent notamment sur la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur les bases techniques du registre d'émissions entre les pays.

La Conférence de Milan (COP9), en 2003 :
Un accord a été conclu sur les lignes directrices du nouveau Fonds spécial pour les changements climatiques dont la priorité est donnée aux activités d'adaptation et de transferts de technologies.
22 décisions ont été adoptées et notamment l'inclusion des projets de boisement et de reboisement dans le Mécanisme pour un Développement Propre avec une garantie de transparence d'information sur les projets ; l'adoption du budget avec une augmentation de 6%, ainsi qu'une allocation intérimaire pour financer la mise en oeuvre du Protocole une fois entré en vigueur ; la validation de nouvelles lignes directrices pour le Fonds spécial pour les changements climatiques et pour le Fonds pour les pays les moins avancés ; un programme de travail sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques, s'appuyant sur le troisième rapport du GIEC.

La Conférence de Buenos Aires (COP10), en 2004 :
La conférence avait fait pour objectif de ramener les Etats-Unis à la table des négociations climatiques. Les États-Unis ont clairement refusé toute possibilité de se joindre au protocole, même dans une version moins contraignante, surnommée Kyoto- Lite avancée par le premier ministre britannique, Tony Blair.
Par ailleurs, la conférence a été l'occasion de présenter de nombreux rapports. Un rapport du European Climate Forum, présenté à cette conférence, souligne les conséquences qu'un réchauffement du climat de 1,5 à 2 C** aurait sur les écosystèmes de plusieurs régions du monde. La sécurité alimentaire à cause d'une réduction significative des précipitations pourrait menacer sérieusement l'Asie. La Chine verrait la productivité de ses récoltes de riz amputée de 10 à 20 % et dans l'Arctique, des espèces animales seraient menacées de disparaître, comme les ours polaires, certaines espèces de phoques et plusieurs espèces d'oiseaux.

La Conférence de Nairobi (COP12/CMP 2), en 2006 :
La conférence organisée pour la première fois en Afrique sub-saharienne, compte quelques avancées intéressantes pour les pays en développement très touchés par les changements climatiques. Il a été décidé de leur confier le contrôle du Fonds pour l'Adaptation qui permettra le financement de projets aidant les populations les plus vulnérables à s'adapter aux impacts des bouleversements climatiques. Ce Fonds serait alimenté par une taxe sur les crédits générés par le Mécanisme de Développement Propre (MDP), l'un des trois mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ce qui pourrait générer rapidement plus de 300 millions euros. Les ONG espèrent déjà que cette taxe sera étendue à l'avenir aux autres mécanismes du Protocole de Kyoto ce qui pourrait permettre de doter ce fond de plusieurs milliards de dollars répondant ainsi à la réalité des besoins des pays les plus vulnérables, expliquent-elles. Ce fonds pourrait être opérationnel dès 2007 et serait géré par le Fonds pour l'environnement mondial.
Les gouvernements ont également reconnu la nécessité de mieux répartir les projets MDP dans les pays les plus démunis. Ces MDP restent pour l'instant très localisés en Inde, en Asie et au Brésil tandis que très peu de projets sont enregistrés en Afrique par exemple.

La Conférence de Bali (COP13/CMP 3), en 2007 :
La Conférence de Bali est la 13e conférence des parties sur le changement climatique. En décembre 2007, elle a réuni 189 États signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en vigueur depuis 1994. Le protocole de Kyoto (décembre 1997) est un additif à cette convention, qui engage les principaux pays développés à réduire de 5,2 % par rapport à 1990 leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012. À Bali, l’enjeu était d’établir un calendrier de négociations entre les membres afin de prendre le relais du protocole de Kyoto, qui arrive à échéance en 2012. La conclusion d’un accord succédant au protocole de Kyoto devait se réaliser au plus tard en décembre 2009, lors de la conférence de Copenhague. Laquelle n'a pas abouti à un accord unanime.

La Conférence de Poznań ( COP 14/CMP 4), en 2008 :
Organisées du 1er au 12 décembre 2008 dans la ville polonaise de Poznań, la conférence avait pour objectif de poursuivre la mise en œuvre de la convention-cadre des Nations unies (signée à Bali en 2007) afin de mettre au point d’ici 2013 un nouveau protocole international pour relayer celui de Kyoto. Mais, alors qu'à Bali, en 2007, la négociation avait connu une phase d'expansion relative, la conférence de Poznan s'est caractérisée par sa faible productivité politique. Les principales décisions :
-
La mise en place d’un calendrier de travail qui débutera d’ici mars prochain. La conférence de Copenhague se tiendra du 7 au 18 décembre 2009. L’ONU pourrait convoquer un sommet des chefs d'État sur le climat en septembre.
-
La création d’un Fonds d’adaptation, pour venir en aide aux pays les plus démunis, ceux qui sont aussi les plus vulnérables face aux changements climatiques. Reste que les sommes annoncées semblent dérisoires.
-
La lutte contre la déforestation devient enfin une priorité, le maintien des forêts un effort qui sera pris en compte pour les pays qui acceptent de le faire.
-
Réduction de seulement 5 % globalement des émissions de GES pour les pays industrialisés par rapport à leur niveau de 1990. En 2015 au plus tard, les émissions mondiales devraient avoir atteint un pic d'inflexion et amorcer leur décrue. En 2020, les pays industrialisés devraient avoir réduit leurs émissions de 20 à 30 % minimum.

La Conférence de Copenhague (COP15/CMP 5), en 2009 :
Elle s'est tenue à Copenhague (Danemark), du 7 au 18 décembre 2009. Conformément à la feuille de route adoptée en 2007 lors de la COP 131, elle devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, initié lors de la COP 3 en 1997 et dont la première étape prend fin en 2012. Cette COP 15 était également la MOP 5, soit la 5e réunion annuelle depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto en 2005.
À la suite des négociations menées par 26 pays industrialisés et émergents37, essentiellement les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud40 (et excluant entre autres l'Union européenne37), la conférence s'est terminée sur une déclaration d'intention qualifiée d' « accord »37.
Aucun objectif quantitatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est inscrit dans l'accord. Selon Nicolas Sarkozy, « tout le monde a accepté de donner par écrit les chiffres précis de ses réductions d'émissions d'ici à 2015 ». Ces chiffres font l'objet d'une annexe dans l'accord12 dont le détail devait être dévoilé en janvier 201013.

La Conférence de Cancún (COP16/CMP 6), en 2010 :
Cette 16e conférence s'est tenue peu après la Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya (2010) où les relations et enjeux liant climat etbiodiversité ont été rappelés.
Elle devait prolonger et compléter l'accord de Copenhague de 2009 (non contraignant), construit pour préparer les suites du Protocole de Kyoto.
L'accord contient :
-
Un rappel aux pays les plus industrialisés qu'ils se sont engagés à Copenhague à verser, collectivement, 30 milliards de dollars (22,4 milliards d’euros) aux pays les moins avancés (PMA) d’ici 2012. Ces financements dits « fast start » doivent aider les PMA à diminuer leurs émissions au profit d'alternatives moins polluantes et développer l'adaptation à un réchauffement moyen de 2 °C. Dès 2020, les pays les plus riches se sont engagés à annuellement verser 100 milliards $ (74,67 milliards €) pour aider les pays en développement face aux problèmes climatiques
-
En engagement à créer un fonds mondial vert pour le climat ("Green Climate" fund), devant être abondé à au moins cent milliards de dollars par an d'ici à 2020, pour aider les pays pauvres.
-
Un engagement pour la mise en place du système Redd + : mécanisme qui doit permettre aux pays forestiers, luttant efficacement contre la déforestation, de générer des crédits d’émission, cessibles sur le marché du carbone et des compensation.
-
Un engagement des pays en développement à comptabiliser et publier leurs émissions, ainsi qu'à mettre en œuvre desactions nationales « et appropriées » pour diminuer, d’ici 2020, leurs émissions par rapport à un scénario « business as usual ».
-
La création d'un Comité de l’adaptation au changement climatique
-
Un comité exécutif de la technologie, doit accélérer les transferts technologiques du Nord vers le Sud.

La Conférence de Durban (COP17/CMP 7), en 2011 :
À un an de l'échéance de la première période d'engagements du Protocole de Kyoto, arrivant à échéance le 31 janvier 2012, son principal enjeu était d'adopter un accord évitant un vide juridique entre les deux périodes d’engagement5. À cette fin, la COP-17 devait en opération les Accords de Cancún ce qui nécessitait l'entrée en vigueur et le financement rapide duFonds vert pour le climat promis par les pays développés lors de la Conférence de Copenhague (COP-15).
La “ Décision de Durban ” reconnait que tous les pays doivent faire face de manière urgente à la menace grave et potentiellement irréversible des changements climatiques. Elle a permis le lancement d'une plateforme de négociation (la « Plateforme de Durban » pour préparer un accord post-2020 incluant tous les pays et ayant force légale6 pour - comme le recommandait le GIEC - maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète à moins de 2 °C ou 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel ).

La Conférence de Doha (COP18/CMP 8), en 2012 :
La première à avoir lieu depuis l’établissement de la « Plateforme de Durban pour une action renforcée ». Cette Plateforme de Durban a, au terme de la Conférence de Durban sur les changements climatiques (COP-17) mis en place le Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée (GTPD) chargé d’élaborer le « régime climatique post-2020 ». Ce nouveau régime pourrait prendre la forme d’un protocole, d’un instrument juridique ou d’un résultat concerté ayant force de loi. Il inclura toutes les parties, devra être achevé au plus tard en 2015 et entrer en vigueur en 2020.
Elle concerne l’Union européenne, la Croatie et l’Islande, et huit autres pays industrialisés dont l’Australie, la Norvège et la Suisse, soit 15 % des émissions globales de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. Chaque pays « réexaminera » ses objectifs chiffrés de réduction de GES « au plus tard en 2014 ».
Deuxièmement, la conférence engage à développer l’aide financière aux pays du Sud pour faire face au changement climatique Le texte de Doha ”presse” les pays développés à annoncer de nouvelles aides financières « quand les circonstances financières le permettront » et à soumettre au rendez-vous climat de 2013, à Varsovie, « les informations sur leurs stratégies pour mobiliser des fonds afin d’arriver à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 ».
Ensuite, la conférence se prononce en faveur de la réparation pour les « pertes et dommages » causés aux pays du sud par le réchauffement À Varsovie, des « arrangements institutionnels, comme un mécanisme international, seront décidés au sujet de la question des pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique dans les pays en développement particulièrement vulnérables »
Enfin, la conférence prévoit, comme c'était le cas lors de la Conférence de Durban de 2011 (COP-17), un « accord global et ambitieux » en 2015 L’accord de Doha réaffirme l’ambition d’adopter « un protocole, un autre instrument juridique ou un accord ayant force juridique »

La Conférence de Varsovie (COP19/CMP 9), en 2013 :
Varsovie, qui ne devait être qu'une "conférence d'étape" sans enjeu majeur, aura montré à quel point la défiance reste grande et laisse présager des difficultés qu'il faudra surmonter lors des prochaines étapes à Lima
Tous les pays repartent de Varsovie avec la mission "d'intensifier" leur travail pour élaborer leur contribution à l'accord de 2015.
En savoir plus sur : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/23/climat-un-accord-a-ete-adopte-a-varsovie_3519332_3244.html#1mcvKGZp6w1UYoOw.99

La Conférence de Lima (COP20/CMP 10), en 2014 :
La Conférence de Lima a lieu du 1er au 14 décembre 2014 à Lima au Pérou. Elle est à la fois la 20e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la 10e conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties auprotocole de Kyoto.
Le feu vert a été donné pour entamer les discussions avec le Fonds vert pour le climat afin de déterminer comment les pays peuvent être soutenus dans leurs actions au niveau national.
Le NAP Global Network a été créé par le Président de la COP20 et réuni la Norvège, les États-Unis, l'Allemagne, Les Philippines, le Togo, Le Royaume-Uni, la Jamaïque et le Japon.
Le comité exécutif du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices a été reconduit pour deux ans avec une représentation alternée entre pays développés et non développés.
Le gouvernement péruvien a lancé un nouveau portail "Nazca Climate Action Portal" destiné à renforcer la visibilité sur l'état des finances des plans d'actions parmi les villes, régions, entreprises et investisseurs.
